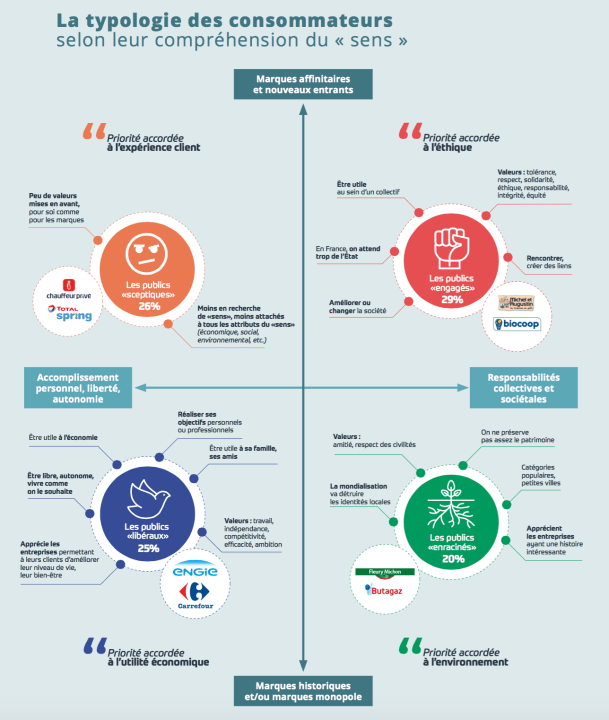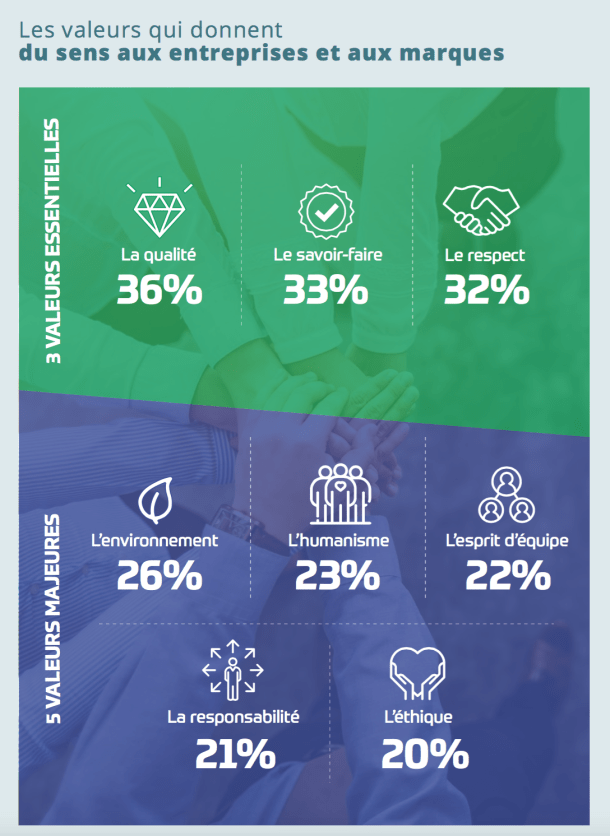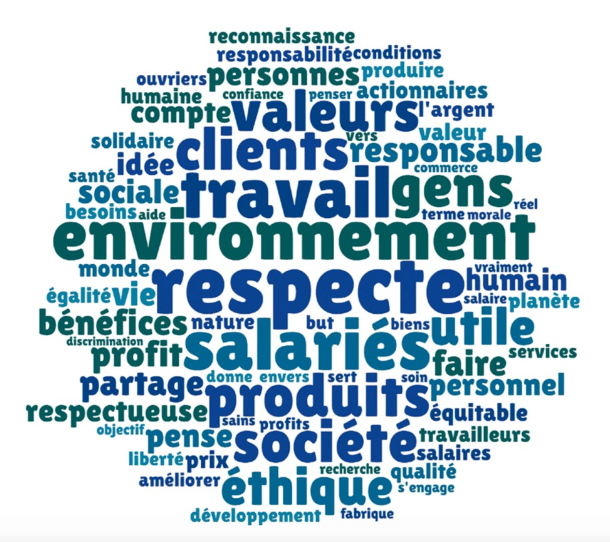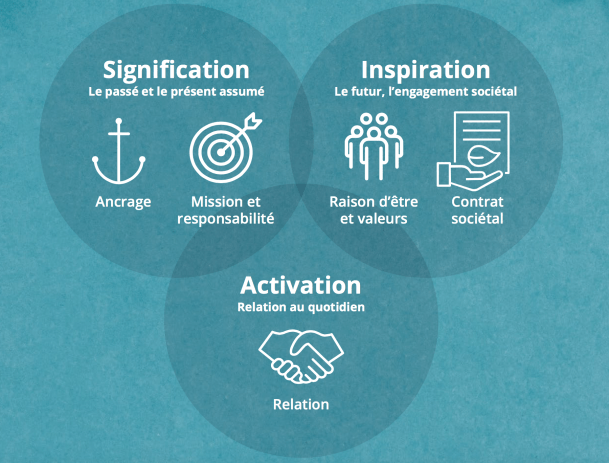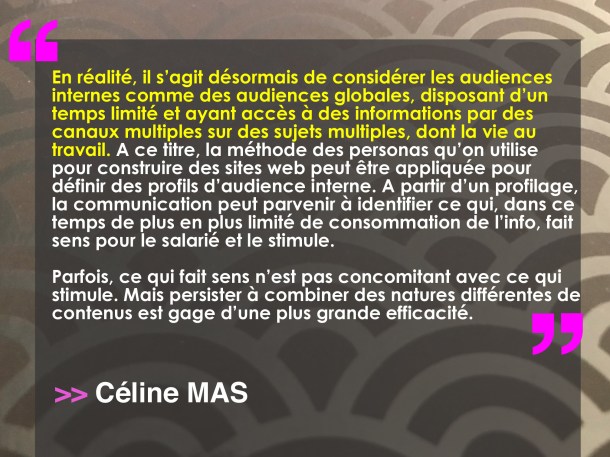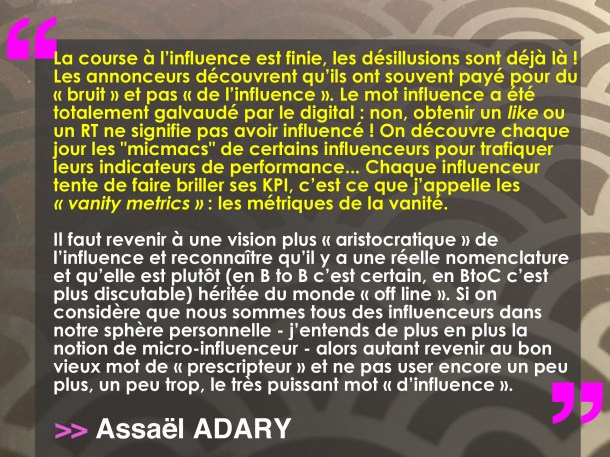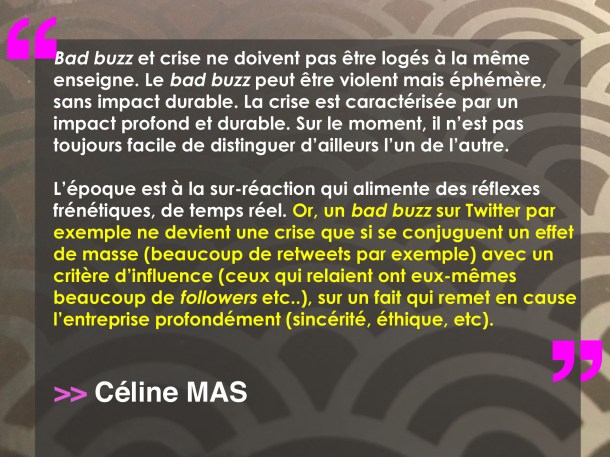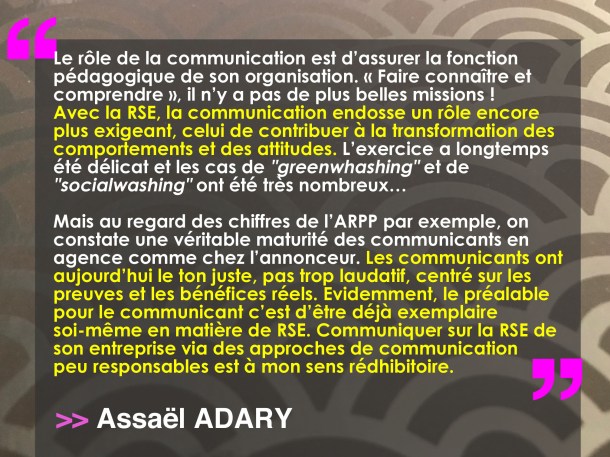S’il est des experts qui savent expliquer des évolutions complexes de manière simple, sans jamais tomber dans le simplisme, Thierry Libaert¹ est assurément de ceux-là.
S’il est des experts qui savent expliquer des évolutions complexes de manière simple, sans jamais tomber dans le simplisme, Thierry Libaert¹ est assurément de ceux-là.
Expert référent en communication des organisations et spécialiste reconnu de la communication de crise et de la communication sensible, cet ex enseignant du Celsa, de Sciences-Po Paris et de l’Université Catholique de Louvain ne manque jamais une occasion de vulgariser (au sens noble du terme) nos métiers, tout en réfléchissant à leur évolution.
J’en veux pour preuve cette vidéo découverte tout récemment – et que je vous recommande – dans laquelle le président de l’Académie des controverses présente de manière synthétique les 9 grandes évolutions ou « tendances lourdes » de la communication, décryptées avec talent et pédagogie :
1) Confirmation de la baisse de confiance des citoyens envers les organisations (exigeant des discours précis fondés sur la preuve) ; 2) Généralisation de la mesure et de l’évaluation de la performance des communications ; 3) Banalisation de la communication de crise (réclamant à la fois souplesse et anticipation) ; 4) Libération d’une communication toujours plus en mouvement (notamment en termes d’identité visuelle) ; 5) Disparition des postures d’autorité ou « de souveraineté » au profit d’une proximité croissante avec les publics (et d’une communication plus incarnée) ; 6) Judiciarisation de la com’ ; 7) Fin de la conception pyramidale de la communication et de la communication « top-down », grâce aux réseaux sociaux, et nouvelle ère de conversation ; 8) Raccourcissement de l’horizon stratégique et de la portée des plans de com’ ; 9) Nouveau rôle de la communication interne…
… Autant d’évolutions qui poussent les communicant.e.s à être de plus en plus agiles, performants et proches de leurs parties prenantes, tout en « jonglant » en permanence entre court et long termes, priorités opérationnelles et indispensable recul stratégique. Thierry Libaert utilise d’ailleurs le terme « d’équilibristes » pour décrire ces professionnels en perpétuelle hybridation, quand la communicante Marie Coudié parlait il y a quelques années de « transformistes » : on le voit, l’agilité est bien le grand mot d’ordre. Agilité à tous les étages…
Pour autant, cette agilité et la primauté de l’opérationnel ne risquent-elles pas de prendre le pas sur la dimension stratégique, comme c’est hélas le cas dans un nombre croissant d’organisations ? La financiarisation de la communication (voir à ce sujet mon article de la semaine passée), sa « ROIsation » et dans une moindre mesure sa judiciarisation ne portent-elles pas en elles les germes du court-termisme et le glas de la créativité ? Et la posture d’équilibriste-transformiste est-elle réellement tenable sans tomber dans le funambulisme ? Le dircom en a-t-il.elle encore les moyens ?
Ce sont là quelques-unes des importantes questions que j’avais envie de poser à Thierry Libaert, suite à sa vidéo. Et bonne nouvelle, il a bien voulu y répondre… Toujours avec la même clarté :) Merci encore à lui pour cette interview éclairante et bonne lecture à toutes et tous !

Le BrandNewsBlog : Encore toutes mes félicitations Thierry pour votre vidéo sur les tendances marquantes de la communication. Sans vous répéter sur ce point, quels sont les grands éléments de contexte à retenir par les communicant.e.s ? En guise de toile de fond, vous évoquez les bouleversements introduits par Internet et les réseaux sociaux, mais aussi la défiance accrue des citoyens envers les institutions et envers toute forme de discours « corporate » ou d’autorité. Qu’en est-il par ailleurs de cette « judiciarisation » que vous décrivez ? Quelles en sont les conséquences pour les communicant.e.s ? Ces évolutions sont-elles irréversibles ?
Thierry Libaert : Beaucoup de tendances s’alimentent. La défiance croissante envers toutes les organisations, et notamment les plus importantes rend plus délicate l’acceptabilité de leurs messages. Ce phénomène est renforcé avec la digitalisation des conversations où la parole de l’entreprise se retrouve noyée dans un flux constant où s’amenuisent les balises de la crédibilité. Tout cela favorise la diffusion des fausses informations et nous savons que celles-ci se diffusent plus rapidement et plus intensément que les vraies. C’est pour cela que la communication doit reposer sur les 3 P : la preuve, la proximité et les parties prenantes.
La judiciarisation est également une tendance structurelle. Le droit est devenu un paramètre majeur de la fonction communication. L’encadrement réglementaire mais aussi normatif de la communication est en très forte augmentation et cela concerne plus particulièrement des secteurs comme l’alimentation, la banque, l’énergie et plus généralement le thème de la transition écologique. Le bon communicant de demain devra aussi être un bon juriste.
Le BrandNewsBlog : Avec des crises qui se multiplient et se banalisent, des priorités stratégiques et opérationnelles qui fluctuent et évoluent de plus en plus vite, on comprend que la communication de crise et la gestion de l’urgence deviennent de véritables leitmotiv pour beaucoup d’organisations. Cette « accélération », qui requiert sans cesse davantage de réactivité de la part des communicant.e.s, ne porte-t-elle pas en elle le risque du court-termisme et d’une communication d’entreprise à courte vue ?
Thierry Libaert : L’accélération du temps est une des caractéristiques fondamentales de l’évolution actuelle de la communication. Cela s’inscrit dans un mouvement plus profond qui traverse toutes les sociétés. J’avais été surpris il y a quelques années de voir que le premier terme utilisé par les agences de relations publiques en Grande-Bretagne était celui de pompier, cela en dit long sur la pratique du métier.
On peut bien sûr expliquer cette accélération par la multiplication des crises, mais aussi par la digitalisation de la communication qui place l’organisation dans une conversation permanente.
Les contraintes spatiales et temporelles sont abolies et l’entreprise est directement exposée en dehors du filtre des médias traditionnels. La digitalisation a également réduit le temps de la production communicationnelle. Jusqu’au début des années 2000, il fallait une dizaine de jours pour réaliser un document écrit avec les divers allers-retours de conception, mise en page, validation, impression. Aujourd’hui, nous évoluons dans un contexte de « juste à temps » qui se vérifie en permanence dans les relations clients-fournisseurs ou dans le real time marketing. On en retrouve une illustration avec la Publicité, historiquement définie comme un métier de création et un media de masse. Celle-ci se transforme actuellement en métier de gestion de la donnée, hyper segmentée, et qui fonctionne avec des algorithmes en temps réel. J’ajoute, en lien avec votre récente interview de Jean-Yves Léger sur son dernier ouvrage, que le poids croissant de la finance dans nos économies impacte directement l’accélération communicationnelle. L’importance des flux financiers, leur internationalisation, et surtout leur volatilité, impose un rythme encore accru à la fonction communication.
J’ai proposé en 2010 l’expression de « slow communication » à l’exemple du mouvement slow food, pour réfléchir aux dangers d’une trop forte rapidité qui se conjugue souvent avec un turn over accru des messages, de l’utilisation des nouveaux supports comme si la communication devait toujours être à la pointe de la modernité.
Le BrandNewsBlog : En expert de la communication sensible et de crise, vous rappelez que la meilleure réponse aux risques repose sur l’anticipation et une bonne préparation de la part des entreprises, l’essentiel se jouant bien avant l’apparition des premiers signaux d’alerte. De même, face à la démultiplication des émetteurs de messages et à la « délinéarisation » de la communication, il est important d’accompagner et de s’assurer de la cohérence des prises de parole émanant de l’entreprise. Ce recul et cet accompagnement ne sont-ils pas difficiles à concilier avec la priorisation du temps court ? « L’agilité » attendue de la part des communicants ne repose-t-elle justement sur une capacité accrue à gérer à la fois le temps court et le temps long ?
Thierry Libaert : Le communicant doit être un équilibriste. Pour surmonter les crises, il faut mettre en place une cartographie des risques, présenter des procédures, proposer des messages, et tout cela prend du temps. Face à la multiplication des interlocuteurs, il faut concevoir un dialogue permanent avec nos parties prenantes et là aussi cela prend du temps. Pour le communicant, c’est souvent la double contrainte ; il doit être dans la réactivité permanente, mais seule la considération du long terme le délivre de la dérive instrumentale de la fonction.
A cette contrainte s’ajoute celle du décalage entre l’accroissement des demandes internes et externes et simultanément une stagnation, voire une réduction des budgets. Etre dans le court terme tout en prévoyant le long terme, faire plus avec moins de moyens : on conçoit que l’agilité soit reconnue comme une qualité centrale.
Il reste que l’agilité n’est rien sans la composante stratégique. Pour avoir longtemps enseigné la communication, j’ai pu observer l’élévation du niveau des études qui ne se contentent plus de présenter la maîtrise des techniques, mais ont intégré progressivement des enseignements de sciences humaines. Cela a permis de donner au communicant une meilleure connaissance des changements en cours dans la société et le monde de l’organisation.

Le BrandNewsBlog : Dans la pratique, il est souvent difficile de concilier temps court et temps long, et malgré la professionnalisation toujours plus forte des équipes communication, les impératifs opérationnels de réactivité ont tendance à l’emporter sur les temps de recul et d’alignement stratégique. Est-ce alors au dircom d’être le garant d’une vision d’ensemble pour l’entreprise ? En a-t-il encore les moyens aujourd’hui ?
Thierry Libaert : Le dircom n’a pas le choix. Pris lui-même entre de multiples contraintes, il est pourtant le seul à pouvoir garantir cette vision d’ensemble.
Je pense qu’après une époque un peu difficile où la communication a pu être vue davantage comme un coût et non un investissement, la légitimité de la fonction communication n’est plus à démontrer. J’en vois trois indices :
- D’abord, l’explosion du numérique a considérablement accru le risque réputationnel et ainsi le directeur de la communication a pu étendre son influence sur des problématiques qui relevaient de la direction des risques.
- Ensuite, la montée des exigences de responsabilité sociale s’est traduite par l’approfondissement des relations avec les parties prenantes, l’accroissement du dialogue et de la concertation avec les multiples interlocuteurs de l’entreprise, donc là aussi, le dircom a élargi son influence, en l’occurrence vers la direction en charge de la RSE.
- Enfin, par le rappel incessant des techniques propres à la communication, de la valeur monétaire de la marque construite par les dispositifs de communication, la direction de la communication a su gagner le respect des autres directeurs. Auparavant, personne n’allait discuter les choix du directeur juridique, financier ou du chef comptable, mais chacun avait son avis sur les actions du directeur de la communication. C’est heureusement moins vrai aujourd’hui, le professionnalisme est reconnu.
Tout cela explique le rôle incontournable du directeur de la communication. Lorsque l’on évoque son rôle de garant de la vision d’ensemble, il suffit d’observer sa forte implication dans les débats sur la raison d’être pour s’en convaincre.
Le BrandNewsBlog : L’évolution du plan de communication est emblématique des évolutions dont nous venons de parler. Ainsi que vous le soulignez, alors que par le passé les stratégies de com’ pouvaient porter sur trois à cinq ans, les plans à un voire deux ans se sont généralisés (quand ce n’est pas six mois) avec la formalisation de quelques grands objectifs annuels que l’on essaie d’atteindre, puis une adaptation au fil de l’eau avec l’ajout de plans d’action ponctuels selon les besoins. Cette nouvelle façon de travailler est-elle pérenne et positive pour les communicants ?
Thierry Libaert : Le plan de communication est un formidable révélateur des évolutions de la communication.
Entre le premier ouvrage que j’avais rédigé sur le sujet à la fin des années 90 jusqu’à la 5ème édition il y a deux ans, j’ai pu diagnostiquer trois changements :
- le plus évident est l’allégement ; les plans de communication de plus de 20-25 pages sont désormais inexistants, ils sont remplacés par des slides qui perdent un peu en contenu.
- Ensuite, le plan comme document unique n’existe plus, il est remplacé par un ensemble de textes comme la politique de la communication, la plate-forme, les valeurs, le plan d’action et demain la raison d’être, sans que l’articulation entre eux n’apparaisse toujours évidente.
- Enfin, et c’est ce qui me désole le plus et qui rejoint le point sur l’accélération temporelle, les entreprises ont du mal à se projeter dans l’avenir et à élaborer une stratégie de communication sur les 2-3 ans à venir. Elles ont souvent la tentation de calquer leur plan de communication sur le plan d’action annuel, simple plan d’allocation des moyens budgétaires. Je persiste à penser que c’est justement lorsque tout s’accélère et devient plus imprévisible qu’une entreprise a le plus besoin d’une image forte, et cela ne peut s’acquérir qu’avec une stratégie de communication axée sur le long terme.
Je crois néanmoins que beaucoup d’entreprises reviennent à des planifications de plus long terme, c’est d’ailleurs le seul moyen de donner de la cohérence à leurs actions, de se distinguer, de capitaliser sur l’ensemble des moyens engagés. C’est aussi un moyen de rétablir la confiance, car comment croire en la réalité des engagements sur le développement durable d’une entreprise si celle-ci modifie en permanence son positionnement ? Sans durabilité, il ne peut y avoir de confiance.
Le BrandNewsBlog : Agilité accrue, réactivité opérationnelle et anticipation de nouveaux risques… Il est aussi demandé aux communicant.e.s d’être encore plus efficaces et experts. Ainsi que vous le dites, l’intégration de la mesure et de KPI a tendance à se généraliser pour toute action de communication. En parallèle, la communication cherche à se rapprocher au plus près de ses publics, en privilégiant l’incarnation des messages et les canaux de relation directe à la communication à distance et désincarnée. Autant de bonnes nouvelles pour les communicant.e.s, car gages d’efficacité et de crédibilité ?
Thierry Libaert : En communication, rien n’est jamais binaire, cela fait aussi tout son intérêt. Sur la mesure, personne ne peut contester les progrès réalisés. Elle concerne désormais tous les domaines de communication, là où pendant très longtemps elle s’était cantonnée aux retombées presse. Elle a pris en considération l’apport des études qualitatives, elle a affiné ses techniques et surtout elle a réussi à dépasser l’évolution de l’efficacité des outils pour s’intéresser aux effets engendrés en fin de cycle (outputs / outcomes / outtakes).
Trois défis sont encore à relever. D’abord celui du célèbre ROI final, c’est-à-dire la contribution de la communication à la valeur ajoutée : je crois qu’il faut être encore très prudent dans ce domaine. Ensuite, je suis méfiant envers la multiplication des indicateurs. Sans stratégie claire, les indicateurs sont inutiles, voire dangereux. Un pilotage purement réactif basé sur la lecture des indicateurs peut conduire à un pilotage un peu instable. Enfin, il reste des points noirs, comme la méthode de l’équivalent publicitaire qui consiste à comparer les retombées presse selon l’achat d’espace publicitaire. Alors que d’un point de vue scientifique, il ne présente aucune valeur, il reste très utilisé notamment parce qu’il est facile à calculer et symboliquement parlant au sein d‘une entreprise.
Sur la relation directe permise par le digital, ici également une certaine dose de prudence s’impose. J’avais, il y a quelques années, dirigé une thèse à l’Université de Louvain qui montrait que derrière les discours de dialogue permanent, l’essentiel de la présence des entreprises sur les réseaux sociaux était encore très marqué par la publication unilatérale d’information promotionnelle. La recherche d’un réel dialogue était encore limitée. Mais en toute hypothèse, c’est clairement par cette voie de l’échange direct que la confiance pourra se réinstaller.

Le BrandNewsBlog : Vous avez publié récemment un ouvrage sur le Pilotage de la communication (dont nous reparlerons certainement), cela va dans le même sens. Quels sont les principaux (voire les nouveaux) outils de pilotage à disposition des communicant.e.s ?
Thierry Libaert : La communication responsable a beaucoup évolué depuis son émergence à la fin des années 80. Après son apparition dans le domaine de la communication corporate (Rhône-Poulenc) et dans celui de la communication produit (Henkel, Reckitt & Colman), elle s’est intégrée progressivement à l’ensemble des domaines d’action comme le mécénat ou l’événementiel. Sous la pression des idées de développement durable, elle s’est détachée du seul angle environnemental dans lequel elle a longtemps été cantonnée, et notamment, sur celui des émissions de gaz à effet de serre, pour s’élargir à une perspective sociétale plus large.
Plus globalement, après avoir dirigé un centre de recherches en communication, j’ai pu observer que s’il est un domaine où les travaux des chercheurs peuvent nous apporter des résultats majeurs, c’est bien celui-là. Le fait qu’une valorisation excessive de l’argument environnemental est au mieux inefficace, et souvent se transforme en effet boomerang, a été clairement démontré. Nous savons aussi que les messages RSE doivent être spécifiques, précis et factuels pour être crédibles². Les messages généraux n’ont aucune efficacité.
La communication, mais aussi les séries télévisées, le cinéma surtout hollywoodien, nous ont inculqué un imaginaire du bonheur par la consommation. La perception des limites de notre planète et les derniers rapports prospectifs nous interrogent plus que jamais sur notre métier de communicant. Loin de verser dans une démarche de culpabilisation, il s’agit seulement de s’interroger sur notre rôle sociétal et de relever un des plus beaux défis qui soient.
La publicité a longtemps été le révélateur des dérives du greenwashing, le problème est pour l’essentiel réglé et il faut reconnaître l’excellent travail accompli par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, les acteurs de l’AACC et de l’Union des Marques. Je pense toutefois qu’il faut aller plus loin. Au regard des enjeux actuels il ne suffit plus de considérer la communication sur des sujets de responsabilité, il faut s’interroger sur la responsabilité même de la communication dans le monde actuel. Je crois que c’est un peu le sens de la mission que le Ministre de la transition Ecologique vient de me confier³.
Le BrandNewsBlog : Pour vous, même les identités visuelles des entreprises se sont « libérées » ces dernières années (cf vidéo), pour accompagner la nouvelle ouverture des entreprises et leur proximité. On abandonne pour de bon les communications d’autorité et les affres de la communication « top-down » ?
Thierry Libaert : Les logos constituent une sorte d’hyper concentré de l’image que souhaitent diffuser les entreprises. Suivre leur évolution est un formidable moyen de compréhension des changements d’objectifs organisationnels.
Sur une longue période, on s’aperçoit ainsi que les logos qui montraient une image de puissance ou de souveraineté, souvent à base de blason, ont disparu. Les formes qui étaient souvent sous un format fermé, carré ou rectangulaire, se sont arrondis et souvent ouverts (cf pour exemple ci-dessous, les évolutions des logos d’Accor et d’EDF). De même, les logos se sont fortement simplifiés. Les formes enchevêtrées, complexes ou à base de plusieurs éléments ont évolué vers des formats plus réduits. Cela s’explique bien sûr par une volonté d’accessibilité et de proximité, mais aussi en raison du changement du principal support du logo qui n’est plus le papier, mais le web.


Cela permet aussi à l’organisation d’introduire davantage de profondeur ou de dynamisme en jouant sur des effets de relief. Les identités visuelles ont suivi en cela la transformation des signatures institutionnelles où, là également, il y a ce basculement des messages de leadership vers une communication qui se veut plus humble, plus proche et surtout plus relationnelle. La communication des entreprises est en cela un excellent révélateur des évolutions de notre société.
Notes et légendes :
(1) Expert référent en communication des organisations et Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Thierry Libaert a enseigné au CELSA, à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à l’Université catholique de Louvain. Il est actuellement conseiller au Comité Economique et Social Européen et président de l’Académie des controverses et de la communication sensible.
(2) Stéphanie Robinson, Meike Eilert, “The role of message specificity in corporate social responsibility communication”, Journal of Business Research,n° 90, 2018, p. 260-268.
Crédit photos et illustration : 123RF, Thierry Libaert, The BrandNewsBlog 2019





 La crise serait-elle en passe de devenir la nouvelle norme en communication ?
La crise serait-elle en passe de devenir la nouvelle norme en communication ? 
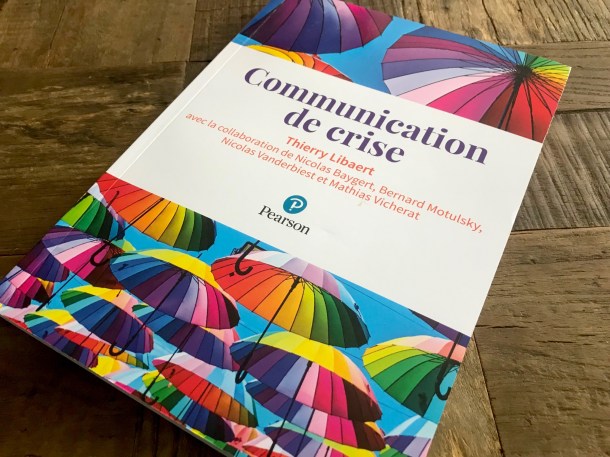

 Signe des temps ? On ne peut plus aujourd’hui ouvrir un livre ou une revue de management
Signe des temps ? On ne peut plus aujourd’hui ouvrir un livre ou une revue de management