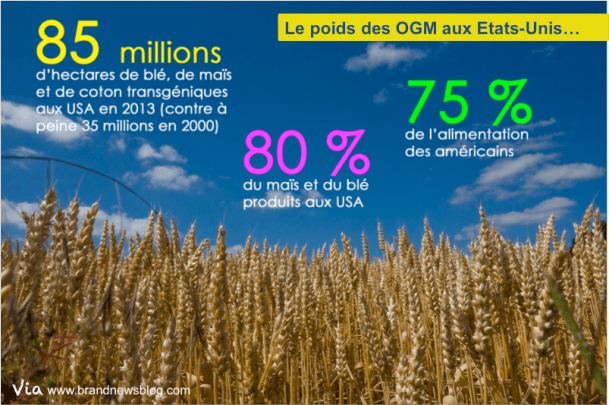Le mois dernier, le magazine Capital consacrait un dossier spécial aux nombreux atouts dont notre pays dispose pour espérer sortir enfin de la crise. L’hebdomadaire du groupe Prisma Média insistait en particulier sur la qualité reconnue de notre enseignement supérieur, sur le nombre important des créations d’entreprises, sur le dynamisme de nos start-up dans le domaine des hautes technologies… Et se félicitait de notre capacité d’exportation dans les domaines de l’agroalimentaire, de la gastronomie, du design, des arts visuels et de l’animation notamment.
Sur une carte de l’hexagone, Capital pointait par ailleurs, région par région, la centaine de PME sur lesquelles la France peut compter pour nous offrir un avenir un peu plus radieux…
Le BrandNewsBlog se devait de relayer l’initiative, ne serait-ce que pour saluer le dynamisme de ces marques dont on parle souvent assez peu et qui sont plus connues de leurs clients et prospects que du grand public. Car leur action et leur influence sur le terrain sont au moins aussi fortes que celles de nos fleurons du CAC40, en termes de croissance et d’emploi surtout.
Des PME championnes mondiales ou championnes européennes sur leurs marchés respectifs…
Antalis (n°1 européen et n°3 mondial de la distribution papetière), Bongrain (un des leaders européens de la transformation de lait), Delachaux (champion planétaire de la production de chrome métal pour l’aéronautique et l’énergie), Ingénico (un des leaders des solutions de paiement), Manutan (leader européen de la distribution de fournitures industrielles), Parrot (pionnier des périphériques sans fil pour téléphone mobile), RAJA (plus gros distributeur d’emballages d’Europe), Vilmorin (acteur des semences potagères), Soufflet (plus gros transformateur de céréales de la planète), Manitou (leader des chariots élévateurs : voir la photo ci), Dodo (plus gros fabricant européen de couettes et d’oreillers)… Les entreprises tricolores qui sont leaders européennes ou mondiales dans leur spécialité sont plus nombreuses qu’on l’imagine. Et elles représentent souvent dans leur région d’origine des locomotives économiques et des employeurs de référence…
Un potentiel considérable en termes de croissance, d’emploi et de développement à l’international
Fortes de 250 à 5 000 salariés, ces marques distinguées par Capital sont de véritables pépites dans leur domaine d’activité. Comme Morpho (filiale de Safran), leader mondial de l’identification biométrique qui a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros et est déjà présente dans 40 pays, elles ont su innover sur leur marché et se développer à l’international.
Beaucoup moins connues du grand public que les fleurons du CAC40, il arrive d’ailleurs que ces entreprises soient plus célèbres à l’étranger qu’en France, car elles sont souvent fortement exportatrices. Elles représenteraient en effet un tiers de notre PIB… et pas moins de 30 % de nos d’exportations !
Championnes de la croissance organique et de l’innovation, ces entreprises ont également su, quand il le fallait, procéder à des acquisitions ciblées à l’étranger. Comme le rappelait Capital, sur les 2 500 entreprises étrangères acquises par des entreprises françaises durant les cinq dernières années, seule une demi-douzaine ont coûté plus d’1 milliard d’euros. La grande majorité des acquisitions, au-delà de l’activisme de nos grands groupes du luxe et de l’agroalimentaire (Kering, LVMH, L’Oréal, Danone, Pernod-Ricard…) est l’oeuvre de ces PME, qui investissent à chaque fois quelques millions ou dizaines de millions d’euros dans leurs opérations de croissance externe.
Découvrez ci-dessous, avec toutes les informations correspondantes, la carte de ces 100 marques méconnues qui font bouger la France (cliquez sur l’image pour l’aggrandir dans son format maximal) :
Source de l’article : « 100 PME méconnues… championnes du monde« , Nathalie Villard, Capital n°275 (août 2014)
Infographie : Magazine Capital, Guy Verny / adaptée pour les besoins du blog par TheBrandNewsBlog