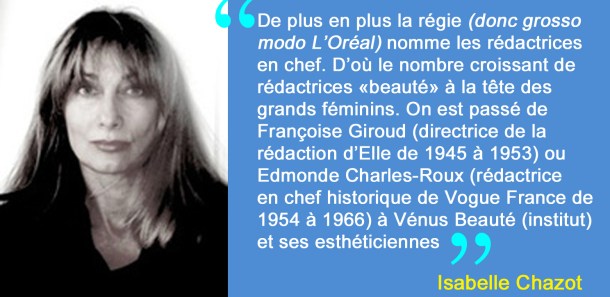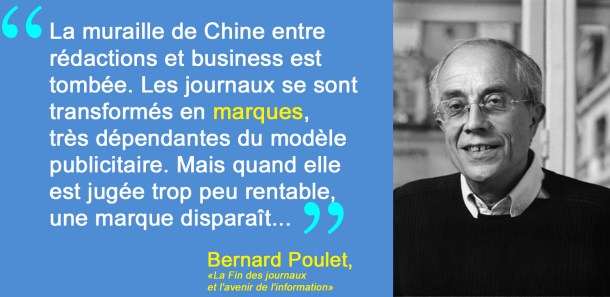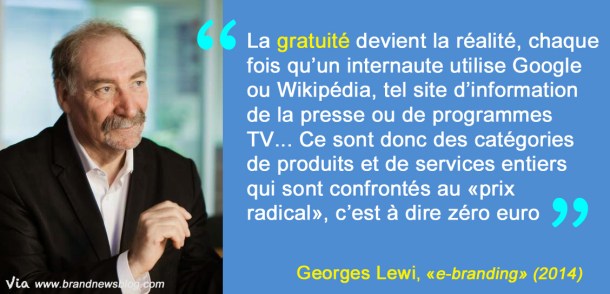Trop de marques dans les contenus et pas assez de contenus qui marquent ? Voilà, résumés en une formule de mon cru, quels semblent être les maux dont souffre la presse féminine, si on se fie au bon article de Céline Cabourg à ce sujet*.
Il faut dire que que cette presse, jadis prospère, est désormais bien malade. Et s’il est encore trop tôt pour affirmer que le « pronostic vital est engagé », force est de constater que la crise est profonde et multiforme. Tandis que les ventes décrochent et que les recettes publicitaires se réduisent, la pression financière s’accentue et les navires éditoriaux tanguent dangereusement, même (et surtout) au sein des plus prestigieuses rédactions…
Fraîchement débarquée de son poste par Denis Olivennes (le patron du pôle média du groupe Largardère), la directrice de la rédaction de « Elle », Valérie Toranian, a par exemple été remplacée aux commandes de l’hebdomadaire par une rédac-chef de « Libération » (voir ici). Avec une feuille de route plutôt relevée.
Devenus trop « lisses » et interchangeables selon les uns, trop mercantiles pour d’autres, les grands magazines de la presse féminine ont-ils été trop loin dans la confusion des genres avec leurs plus grands clients, les marques de luxe ? Ont-ils renié leur identité et définitivement basculés du côté obscur du branded content ?
Le télescopage récent des unes de « Grazia » et de « Elle » (voir ci-dessous) semble en attester : il y a urgence à ce que les féminins se reprennent… Mais, soumis aux mêmes pressions ou presque, les autres familles de presse ne sont pas exemptes de tout reproche, loin s’en faut. Une sérieuse autocritique s’impose.
Le téléscopage de trop, ou l’art de faire de malencontreux copier-collers…
Voilà qui a fait du vilain. En pleine fashion week parisienne, le téléscopage des couvertures et dernières de couverture de « Elle » et de « Grazia », quasiment identiques, n’a pas manqué d’alimenter un bad buzz. De part et d’autres, deux mannequins (dont Claudia Schiffer) portant exactement le même modèle de robe noire, signée Dior, sur des fonds monochromes. Et deux pubs, certes différentes, pour la maison Dior en quatrième de couv. Une coïncidence un peu forte de café, qui illustre un manque de créativité flagrant, derrière l’asepsie du traitement photo et le manque de véritable parti pris.
N’était le phénomène de fail sur les réseaux sociaux, cette malheureuse erreur commune aurait pu passer relativement inaperçue, dans un contexte économiquement porteur notamment. Mais dans une période de baisse cumulée des ventes (- 9% pour « Grazia » et – 13,8% pour « Glamour » en 2013) des abonnements et des rentrées publicitaires (- 7% pour « Elle »), la mésaventure a fait désordre. Etayant les arguments de ceux qui, depuis des années, dénoncent la dérive des féminins…
Pipolisation, focalisation sur la mode et la beauté + confusion des genres : des dérives nées de la financiarisation des années 2000
Victimes d’un double relâchement, les magazines féminins « ont cessé d’être à l’avant-garde des phénomènes de société et ont troqué l’obsession qu’ils avaient de captiver leurs lectrices contre un penchant trop appuyé à faire les yeux doux aux grandes marques de luxe » pour Céline Cabourg.
Dans une passionnante interview accordée aux « Inrocks » en début d’année**, Isabelle Chazot, rédactrice en chef historique du magazine 20 ans (de 1990 à 2003) ne dit pas autre chose… Car elle a assisté, aux premières loges, à cette évolution de la presse féminine vers la pipolisation et la confusion des genres : « Depuis une dizaine d’années, ça s’est aggravé, les féminins grand public se sont mis à tous se ressembler. Maquette, codes couleur, sujets, ton… sans les logos, on aurait du mal à les différencier. A part « Causette », qui a été conçu en rupture formelle avec les autres, et peut-être « Stylist », qui possède une certaine originalité de format et de maquette… ».
De fait, au-delà des orientations financières et stratégiques, présidant à la constitution et au développement de « marques médias », la presse est avant tout une question d’hommes et de femmes pour Isabelle Chazot… et devrait toujours le rester : « Quand j’ai commencé, la régie publicitaire était très éloignée de la rédaction. Et cela fonctionnait, car un magazine n’est pas un produit “marketable” comme un autre. C’est un produit culturel, quoi qu’on dise. Et il doit garder un côté artisanal : une rédactrice en chef très investie (et non une vendeuse de luxe ou une super attachée de presse), une équipe stable et si possible soudée, des collaborateurs réguliers… Tout cela garantit une persévérance dans la ligne éditoriale, une exploration de sujets inédits, une émulation entre les titres. Ce qu’on appelle l’âme d’un journal »
Et c’est malheureusement cette âme que, sous l’influence croissante des services publicité et marketing, les magazines féminins ont progressivement sacrifié, en abandonnant graduellement et pour la plupart les grands sujets de société, au profit des sujets modes et beauté principalement.
Des titres qui se rapprochent de plus en plus de consumer magazines…
Native adverstising, opérations spéciales et porosité croissante entre les contenus rédactionnels et publicitaires aidant, la frontière entre information et branded content s’amenuise souvent dangereusement. A l’exception notable du magazine « Marie-Claire », qui a su conserver et renouveler sa ligne éditoriale, en modernisant son traitement de l’actualité notamment (ses ventes résistent pour le coup à un bon niveau), force est de reconnaître que les autres grands féminins semblent avoir abdiqué toute ambition dans ce domaine.
Edifiante est à ce sujet l’évolution du magazine « Grazia ». Positionné comme un magazine d’actualité à son lancement (ses journalistes avaient été recruté au sein des rédactions généralistes), le titre avait réussi à faire cohabiter grands sujets politiques et sociétaux, faits divers et mode. Hélas, et comme le regrette sa rédactrice en chef de l’époque, Yseult Williams, le succès rencontré en kiosque (196 000 ventes par semaine) n’était pas à la hauteur des attentes de l’actionnaire Mondadori, qui tablait sur un tirage à 250 000 exemplaires. Le titre a progressivement évolué vers un positionnement « conso », très voisin de celui de ses concurrents. La pression financière a une fois encore été trop forte pour arriver à préserver une véritable identité rédactionnelle… et résister au poids croissant de la régie pub.
De fait, comme le rappelle dans son article Céline Cabourg, cette dérive et la « bascule » de la presse magazine s’est opérée à peu près à la même époque pour la plupart des titres. « La muraille de Chine entre rédactions et business est tombée. Les journaux se sont transformés en marques, très dépendantes du modèle publicitaire. Mais quand elle est jugée trop peu rentable, une marque disparaît » confirme Bernard Poulet, rédacteur en chef à « l’Expansion » et auteur du livre « La Fin des journaux et l’avenir de l’information ». La confusion des genres est telle que quand les marques se sont mises à lancer leur propre magazine beauté, c’est le plus souvent dans les rédactions des féminins qu’elles sont allées débaucher leurs équipes. Et les meilleurs talents (stylistes, rédactrices/rédacteurs, photographes) n’ont pas hésité à franchir le pas, ou à se tourner vers un autre type de presse, plus novateur.
Les marques aussi ont besoin d’une presse forte… et indépendante
Les magazines féminins ne sont pas les seuls à avoir capitulé aux desiderata de leur régie… pour rentabiliser un modèle économique exsangue. Dans un article illustré de nombreux exemples concrets, Nicolas Vanderbiest stimatise les dérives de cette presse qui « se flingue » en diluant sa ligne éditoriale (si tant est qu’il y en ait une) dans une avalanche de sexe, de trash et une confusion permanente entre traitement de l’actualité et auto-promotion (lire ici son article récent à ce sujet).
Quand tous les groupes de presse ambitionnent de devenir de grandes « marques média »… gare aux dérapages ! Car ce que les lecteurs et le public veulent avant tout, quel que soit le média, tient dans une formule simple : une information fiable, sérieuse et vérifiée, qui oriente le lecteur en l’éclairant de manière impartiale sur l’actualité et les sujets de société. Il appartient donc aux rédactions et surtout aux patrons de presse, leurs actionnaires, de garantir une ligne éditoriale stable, à la hauteur de ces enjeux, s’ils espèrent maintenir durablement à flot leurs navires.
Et il est de la plus haute importance pour les marques elles-mêmes de pouvoir compter sur une presse crédible et indépendante, faute d’accentuer par des stratégies à courte vue cette énorme défiance qui sape les fondements de toute information… et leur propre crédibilité. Ceux qui ne l’ont pas encore compris sont passés à côté de toutes les évolutions de ces quinze dernières années.
Sources et notes :
* « Plus lisses tu meurs : comment les féminins ont sombré dans la crise », par Céline Cabourg et Yasmine Kaiser, obsession.nouvelobs.com, 12 octobre 2014.
** « Presse féminine : les magazines sont devenus des magasins », interview d’Isabelle Chazot par David Doucet, lesinrocks.com, 30 janvier 2014
« Une nouvelle patronne pour Elle, venue de ‘Libération », source AFP – leschos.fr, 23 septembre 2014
« Sexe, trash, recherche du buzz et intérêts financiers : pourquoi la presse se flingue ! », par Nicolas Vanderbiest, reputatiolab.com, 9 octobre 2014
Crédit photos :
Photo 1 : TheBrandNewsBlog – Photo 2 : Killian Beaucardet pour Le Nouvel Observateur
Citations : TheBrandNewsBlog